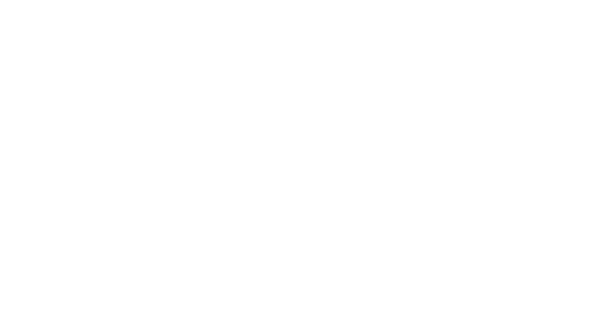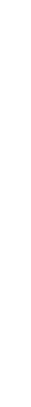Retour sur 20 ans de progrès
dans la recherche sur les maladies mitochondriales
Les avancées en recherche sur les maladies mitochondriales ont considérablement amélioré la précision diagnostique, réduisant les erreurs et les situations d’impasse fréquente par le passé.
Ainsi, établir non seulement un diagnostic fiable de pathologie mitochondriale mais également d’exclure cette hypothèse lorsque nécessaire sont des progrès significatifs.
Ces progrès diagnostiques s’accompagnent d’une révolution majeure dans le domaine du conseil génétique, permettant un accompagnement éclairé des familles dès le stade prénatal, et ouvrant la voie à une prise en charge mieux adaptée et plus précoce.
Avancées diagnostics majeures

Les progrès techniques ont permis d’améliorer considérablement le diagnostic des maladies mitochondriales.
La transition du séquençage Sanger, limité à une dizaine de gènes sur les 300 existants, au séquençage de nouvelle génération (NGS) dès 2010, puis à l’accès au séquençage génomique complet (WGS) en 2020, a considérablement accru la précision et la rapidité des diagnostics.
Grâce à un meilleur diagnostic, il y a de plus en plus de possibilités de diagnostic prénatal et préimplantatoire. Ces technologies permettent une prise en charge rapide, un diagnostic précis, et limitent les situations d’impasse thérapeutique.
1 gène/ 1 patient
200 gènes/ 23 patients
L’activité de laboratoire de l’IHU Imagine


Entretien avec Agnès Rötig,
Directrice du laboratoire de recherche sur les maladies mitochondriales à l’Institut Imagine.
Bonjour Agnès, depuis dix ans votre laboratoire est dédié à la recherche sur les maladies mitochondriales. Quels sont les principaux objectifs de vos travaux ?
Agnès Rötig : Nos recherches s’articulent autour de trois objectifs principaux. Tout d’abord, nous travaillons à identifier de nouveaux gènes nucléaires responsables de maladies mitochondriales afin de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques sous-jacents.
Cette compréhension approfondie est essentielle pour explorer des pistes thérapeutiques.
Nous cherchons également à améliorer notre connaissance des maladies associées à des mutations de l’ADN mitochondrial (ADNmt), notamment en ce qui concerne la ségrégation de ses mutations au cours du développement embryonnaire.
Quelles avancées avez-vous réalisées dans l’identification des gènes nucléaires responsables de ces pathologies ?
Grâce au séquençage de l’exome entier (WES) et du génome entier (WGS), nous avons découvert plusieurs gènes impliqués dans des fonctions variées des mitochondries. Ces mutations entraînent des déficits de la chaîne respiratoire associés à des manifestations cliniques diverses. Cette approche génétique, combinée à nos travaux en physiopathologie, nous a permis de mieux comprendre l’impact de ces mutations et d’ouvrir des perspectives pour des traitements ciblés.
Votre laboratoire est également très impliqué dans la recherche sur l’ataxie de Friedreich. Pouvez-vous nous parler de vos travaux dans ce domaine ?
L’ataxie de Friedreich est une maladie mitochondriale due à des mutations du gène FXN, qui code pour la frataxine, une protéine mitochondriale. Nous avons démontré que ces mutations altèrent la régulation de l’homéostasie du fer dans les cellules. Nos recherches ont mis en lumière des anomalies de régulation de plusieurs protéines de l’import, du stockage et de la sortie du fer de la cellule ce qui conduit à une accumulation de fer intracellulaire. Nous avons également montré que l’artésunate, médicament utilisé pour le traitement du paludisme, agit sur une partie de ces anomalies et permet de diminuer la surcharge en fer. Ces résultats ont conduit à un essai clinique de phase I-II pour évaluer l’efficacité et la tolérance de ce traitement chez des patients atteints d’ataxie de Friedreich.
Parlons maintenant du domaine du diagnostic prénatal et préimplantatoire, des sujets très important pour les familles, quelles sont vos contributions dans le domaine ?
Julie Steffann qui dirige le laboratoire hospitalier de diagnostic génétique fait aussi de la recherche dans mon groupe.
Elle s’intéresse en particulier aux mutations de l’ADNmt qui sont très particulières. En effet, elles se retrouvent à l’état hétéroplasmique car il y a un mélange de molécules normales et mutées de l’ADNmt en proportion parfois variables selon les organes. Julie Steffann a étudié les mécanismes de répartition des mutations normales et mutées de l’ADNmt au cours du développement embryonnaire. Ses travaux ont montré que la proportion de molécules mutées d’ADNmt reste stable à partir de 10 semaines de gestation et jusqu’à la naissance. Cela a permis de consolider la fiabilité des diagnostics prénatals et préimplantatoires. En outre, elle a révélé un risque accru de complications obstétricales chez les porteurs d’ADNmt muté, soulignant l’importance d’un suivi spécifique pour ces grossesses.
Vous explorez également des approches de thérapie génique pour certaines maladies mitochondriales. Quels sont vos résultats à ce jour ?
Nous avons développé des modèles murins pour tester des thérapies géniques par remplacement de gènes. Par exemple, pour les mutations de LRPPRC, impliquées dans des syndromes neurologiques graves, nous utilisons des vecteurs viraux pour restaurer l’expression normale du gène. Nous avons également créé un modèle spécifique de souris atteintes de mutations POLG, permettant d’explorer les effets des thérapies géniques sur des maladies neurologiques incurables.
Ces travaux devraient ouvrir des perspectives prometteuses pour des traitements durables et efficaces.
En conclusion, comment voyez-vous l’évolution de la recherche sur les maladies mitochondriales ?
La combinaison des avancées en génétique, en physiopathologie et en thérapie génique nous rapproche de traitements plus adaptés. Mais le temps de la recherche n’est malheureusement pas celui de la maladie. Il reste encore de nombreux patients sans diagnostic génétique pour lesquels nous avons testé toutes les approches disponibles. Il va falloir maintenant aller vers de nouveaux concepts et de nouvelles technologies pour comprendre l’origine de leur maladie.